|
|
|
La réalité et la fiction >
Bernard
Châtelet, ou plutôt... Camille Desmoulins
Pourquoi Bernard au lieu
de Camille? Allez savoir, je ne sais pas, peut-être parce que
désigner ce personnage directement par Camille Desmoulins
sous-entendait lui donner beaucoup plus de rôle que voulu...
 |
Né à Guise en 1760, mort à Paris le 5 avril
1794. Camille Desmoulins, est le fils d’un officier de
justice. Il entre comme boursier au collège Louis-le-Grand, y
poursuit de brillantes études en compagnie de Maximilien de
Robespierre et de Georges Danton.
Il devient avocat au parlement de Paris en 1785, il plaide peu
et vit chichement aux frais de son père.
Il se lance dans la politique, on le compte comme l’un de ceux
qui soutiennent Mirabeau, malgré son bégaiement, il est l’un
des orateurs les plus écoutés.
Le 12 juillet 1789 il appelle les Parisiens à prendre les
armes suite à l’annonce du renvoi de Necker. |
À la
fin de novembre 1789, il fait paraître le journal « Les
Révolutions de France et de Brabant », qui connaîtra
quatre-vingt-six numéros, où il ne cesse de dénoncer le
complot aristocratique. Le succès du journal assure à
Desmoulins d’importants revenus : il peut ainsi épouser
Lucille Duplessis, riche héritière d’un haut fonctionnaire des
finances.
Desmoulins devint
l’un des orateurs du club des Cordeliers. Il est le protégé et
l’ami de Danton, suppléant à la paresse et, souvent, aux
ignorances de son chef par une continuelle activité de
journaliste et d’agitateur. Partisan des mesures
révolutionnaires les plus violentes, après la fuite de Louis
XVI, il se déclare républicain. |
 |
A l’issue de la fusillade du Champ-de-Mars de juillet 1791
pendant la manifestation républicaine réprimée dans le sang,
il est poursuivi et doit se cacher un moment. Avec Danton il
prépare la journée du 10 août 1792 et la chute de la
monarchie.
Brillant opposant au suffrage censitaire [1], il fait
remarquer, au cours des discussions, qu’une telle loi
électorale exclurait Rousseau et Jésus-Christ de
l’éligibilité. Partisan de la paix, comme Robespierre, en
1792, il change de camp et pétitionne en faveur de la guerre
avec Danton et Marat. En août 1792, il devient secrétaire
général du ministère de la Justice, occupé par Danton.
Il est élu à la
Convention et siège dans les rangs des Montagnards [2] où il
aura un rôle effacé. Robespierre dira de lui « c’est un enfant
gâté » et Barres « Il avait beaucoup d’esprit et trop
d’imagination pour avoir du bon sens ». Cela ne l’empêchera
pas de voter la mort du roi.
Profondément ébranlé par la condamnation des Girondins [3] le
30 octobre 1793, il lance Le Vieux Cordelier le 5 décembre, où
il attaque d’abord les hébertistes, puis, avec un grand
courage, fait de vibrants appels à la clémence.
Arrêté le soir du 31 mars 1794, jugé en même temps et dans les
mêmes conditions que les dantonistes, il est exécuté le 5
avril 1794 en même temps que Danton.
Sa femme Lucille le suivit sur l’échafaud huit jours plus
tard, pour avoir protesté contre son exécution. |
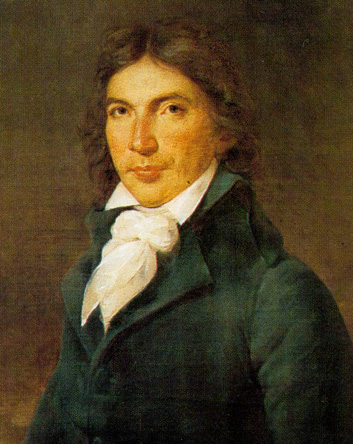 |
1] Système électoral dans lequel le droit d’être électeur ou
éligible n’est accordé qu’aux citoyens payant un minimum
d’impôts.
[2] Pendant la Révolution française nom donné aux députés qui
siégeaient sur les plus hauts bancs (la montagne) de
l’Assemblée législative et qui se distinguaient par leurs
positions extrémistes. Parmi ceux-ci on retiendra Barras,
Collot d’Herbois, Saint Just, Fabre d’Eglantine, Fouché,
Marat, Robespierre, Couthon...
[3] Nom donné à un groupe de députés à la Législative et à la
Convention, dont plusieurs membres étaient députés de la
Gironde.
L'Histoire en Ligne © 1999 - 2005 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
![]()