|
|
|
La réalité et la fiction >
Maximilien de
Robespierre
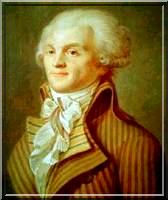 |
Né à
Arras en1758, décédé à Paris le 28 juillet 1794, Robespierre
est issu d’une famille de la petite bourgeoisie. Jeune homme
pauvre et doué, il poursuit des études qui le mènent au métier
d’avocat. Il est élu député du Tiers Etat aux Etats Généraux
après avoir fait une campagne publique.
Représentant de l’extrême gauche démocratique à l’occasion
d’une loi électorale censitaire [1] contre laquelle il est
l’un des seuls députés de la Constituante à s’élever. Au début
de 1791, au club des Jacobins [2], Robespierre est aussi l’un
des premiers à se déclarer favorable au suffrage universel. |
|
Adversaire de la déclaration de guerre en 1792, il s’oppose
aux Girondins [3] et passe au premier rang de la scène
politique avec la chute du roi, le 10 août 1792. Elu député à
la Convention, il réclame la déchéance de Louis XVI et devient
l’un des chefs de file des Montagnards [4]. Appuyé par les
sans-culottes parisiens, il est alors l’un des principaux
artisans de la chute des Girondins (juin 1793). Robespierre
institue une religion civique, qui combat l’athéisme,
reconnaît l’immortalité de l’âme et enseigne aux Français la
haine de la tyrannie et l’amour de la justice. Il est le héros
de la fête de l’Être Suprême qui se déroule partout en France
le 8 juin 1794. |
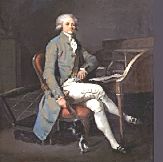 |
Il est aussi à
l’origine de la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794) qui
instaure la Grande Terreur, ôtant aux accusés toute possibilité de
défense ou de recours.
 |
La mise en accusation
Malgré les victoires révolutionnaires (Fleurus le 26 juin
1794), la situation politique de Robespierre se dégrade très
vite. Le Comité de sûreté générale engage la lutte avec le
Comité de salut public. Il y est contesté par Billaud-Varenne
et Collot d’Herbois. Ses adversaires nouent un complot avec le
centre de l’Assemblée. Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794)
Robespierre est empêché de s’exprimer à la Convention, il est
invectivé de toutes parts, il a la gorge serrée, Garnier de
l’Aube lui jette " Le sang de Danton t’étouffe ! ". Puis
soudain un certain Louchet, tout juste connu s’écrie " Je
demande le décret d’accusation contre Robespierre ! " Le
silence venu d’un seul coup pèse sur l’Assemblée, quelques
députés commencent à applaudir, puis c’est l’ensemble, la
proposition est votée à main levée...La cause est entendue. Il
est quatre heures de l’après-midi. |
L’arrestation
Les gendarmes arrêtent Robespierre, Saint-Just et Couthon [5].
Le jeune frère de Robespierre et Le Bas se joignent
volontairement à eux. Pour aller plus vite encore on porte le
paralytique Couthon.
Mais la Commune de Paris (souvent plus puissante que la
Convention), tenue au courant heure par heure de ce qui se
passe à l’Assemblée fait sonner le tocsin, convoque les
sections. Les barrières sont fermées, la place de l’Hôtel de
Ville se hérisse de piques, l’insurrection n’attend plus qu’un
signal que seul Robespierre peut donner.
|
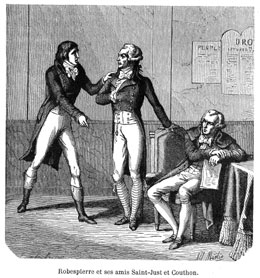 |
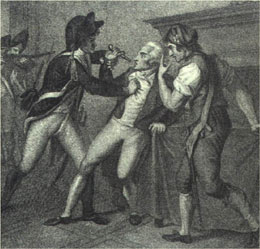 |
Pendant ce temps, chaque prisonnier est conduit vers la prison
qui lui est assignée. Mais le même scénario se reproduit à
chaque fois, dès que le nom de Robespierre est prononcé le
geolier refuse de laisser entrer les gendarmes et leur
prisonnier. La Commune aura très certainement donné des ordres
très précis. Robespierre ne croit pas à l’efficacité d’une
émeute pour lui redonner le pouvoir. De plus trop respectueux
des lois il préfère passer devant un tribunal. Comme il faut
bien aller quelque part, Robespierre propose aux gendarmes de
le conduire à la police municipale, en un mot lui ouvrir les
portes de la liberté. |
Pendant près de deux heures au Quai des Orfèvres il reste
indécis, il ne sait pas quoi faire, il n’aime pas beaucoup les
gens de la Commune les trouvant trop "immoraux". Un émissaire
de la municipalité vient même lui dire " En te sauvant, tu
sauve la liberté ! ". A 9 heures du soir, comme un automate il
rejoint l’Hôtel de Ville. Les autres prisonniers libérés par
la Commune l’y attendent. Ses doutes le reprennent, Saint-Just
le pousse à agir. Faut-il appeler Paris aux armes contre la
Convention et sortir ainsi de la légalité ?
Mise au courant des événements, l’Assemblée s’affole. Les
troupes de la Commune s’approchent parait-il des Tuileries.
Hanriot [6] surnommé par les parisiens "la bourrique à
Robespierre" marche sur la Convention, puis sans aucune raison
apparente hésite et se retire. Les députés reprennent courage,
mettent immédiatement les robespierristes hors la loi, ce qui
équivaut à la mort sans procès. On charge Barras de mater
l’émeute.
Il est deux heures du matin, les troupes parisiennes sont
lassent d’attendre une décision qui ne vient pas. Quand elles
entendent la lecture de l’arrêté de la Convention, elles
commencent à avoir une furieuse envie d’aller se coucher. Peu
de temps après les rangs sont de plus en plus clairsemés. |
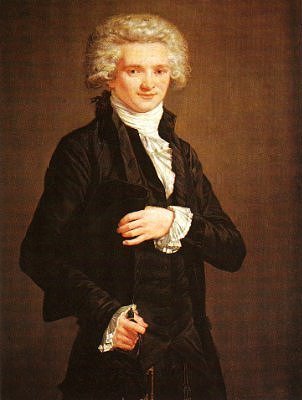 |
Barras fait
irruption sur la place de l’Hôtel de Ville sans rencontrer
beaucoup de résistance, il entre, pénètre dans la pièce où
sont réunis Robespierre et ses amis. Des coups de feu
éclatent, Le Bas se suicide, Couthon tombe du fauteuil où on
l’avait placé, le frère de Robespierre saute par la fenêtre et
se brise la cuisse. Maximilien est gravement blessé à la
mâchoire. A-t-il voulu se tuer ? Un gendarme a-t-il tiré sur
lui ? On ne le saura jamais. Il s’est écroulé, tachant de son
sang une feuille de papier où il venait d’apposer les deux
premières lettres de son nom.
Ce document toujours visible au musée Carnaval et était
l’appel à l’insurrection !
Le procès et l’exécution
A trois heures de l’après-midi les prisonniers sont extraits
de la Conciergerie pour être conduits au Tribunal
révolutionnaire. L’accusateur public Fouquier-Tinville va
requérir contre ses anciens chefs. Pas d’interrogatoire et pas
de défense pour les hors la loi. On va simplement faire
constater l’identité des accusés par deux personnes de
l’assistance.
Quelques heures plus tard tout est fini. L’après-midi du 28
juillet, sous les acclamations de la foule, il est guillotiné
place de la Révolution (Place de la Concorde), avec son frère
Augustin, Saint-Just, Couthon et dix-sept autres de ses
partisans. Les jours suivants, quatre-vingt de ses partisans
sont exécutés.
Note : Une partie de ce récit provient du livre " La
Révolution Française" d’André Castelot (Librairie Académique
Perrin). |
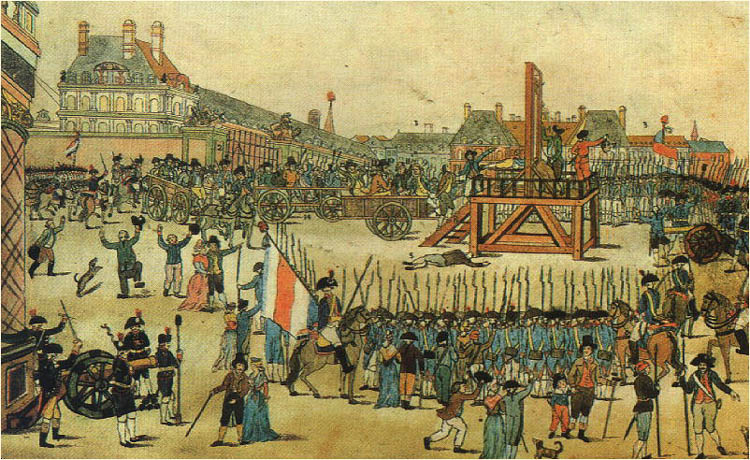
[1]
Système électoral dans lequel le droit d’être électeur ou éligible
n’est accordé qu’aux citoyens payant un minimum d’impôts.
[2] Société politique qui joua un rôle important pendant la
Révolution française de 1789 à la fin de 1794. En janvier 1790, le
club prend le nom de Société des amis de la Constitution et tint
ses réunions au réfectoire du couvant dominicain des Jacobins
situé rue Saint Honoré à Paris. Jusqu’en juin 1791 et avant la
fuite du roi, le club rassemblait tous les députés patriotes.
Citons parmi ses membres Barnave, La Fayette, Mirabeau,
Talleyrand, Sieyès, Petion...
[3] Nom donné à un groupe de députés à la Législative et à la
Convention, dont plusieurs membres étaient députés de la Gironde.
[4] Pendant la Révolution française nom donné aux députés qui
siégeaient sur les plus hauts bancs (la montagne) de l’Assemblée
législative et qui se distinguaient par leurs positions
extrémistes. Parmi ceux-ci on retiendra Barras, Collot d’Herbois,
Saint Just, Fabre d’Eglantine, Fouché, Marat, Couthon...
[5] Homme politique français né à Orcet en Auvergne en 1755,
décédé à Paris en 1794. Conventionnel, membre du Comité de salut
public, cet infirme paralysé des jambes forma, avec Robespierre et
Saint-Just, le « triumvirat de la Terreur ». C’est lui qui fit
voter la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794), privant de toute
garantie les suspects traduits devant le Tribunal révolutionnaire.
Il fut guillotiné avec Robespierre le 10 thermidor an II (28
juillet 1794).
[6] Révolutionnaire français né à Nanterre en 1761, décédé à Paris
en 1794. Chef des sans-culottes, il prit part à la journée du 10
Août et aux massacres de septembre 1792 et fut commandant de la
Garde nationale en 1793. Il périt sur l’échafaud avec Robespierre
et ses amis.
L'Histoire en Ligne © 1999 - 2005
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
![]()